La guerre commerciale transatlantique : l’Europe à l’épreuve de Trump
Par Christophe Rodrigues, professeur de chaire supérieure en économie.
Ce texte, proposé en libre accès, constitue l'éditorial du numéro de la Revue diplomatique n°25 de l'Iega consacré aux relations transatlantiques.
Comment citer cette publication
Rodrigues, Christophe. « La guerre commerciale transatlantique : l'Europe à l'épreuve de Trump », éditorial dans Les relations transatlantiques : l'Europe face à un tournant, Yohan Briant, Alexandre Negrus (dir.), Revue diplomatique, n°25, Institut d'études de géopolitique appliquée, Paris, 2025. Éditorial en libre accès.
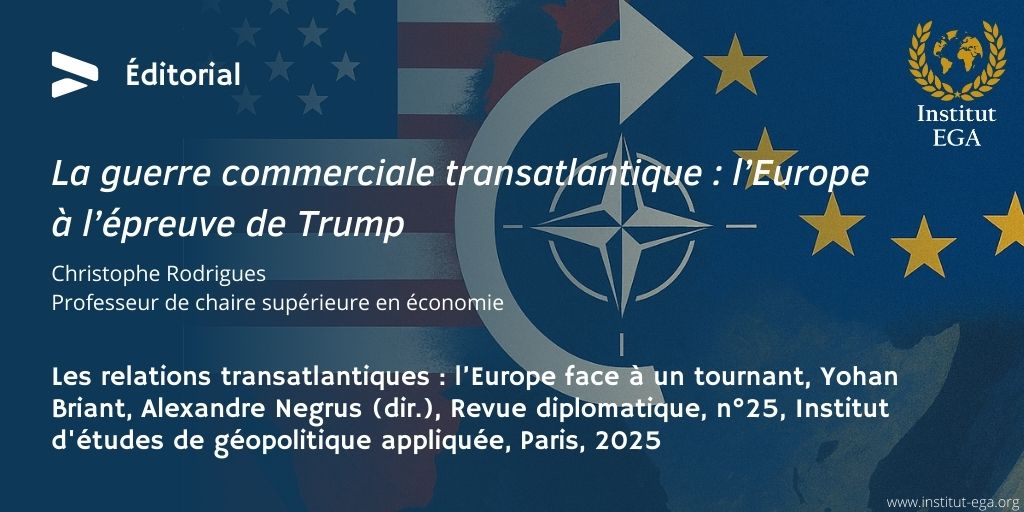
De quoi la guerre économique est-elle le nom ?
Depuis son investiture en janvier 2025, Donald Trump a engagé les États-Unis dans une stratégie politique internationale fondée sur un unilatéralisme très agressif. Cette politique que l'on peut qualifier de guerre économique dépasse largement la simple question commerciale : elle articule certes des mesures protectionnistes sur les échanges de biens et services, mais aussi des pressions monétaires avec le rôle aujourd'hui très ambivalent du dollar qui reste la devise clé par excellence alors que son taux de change est pourtant tiré à la baisse et enfin une tension financière inédite liée à l'ampleur de la dette publique et privée US financée notamment par l'épargne européenne. La science économique a montré, de longue date, quelles sont les vertus de la concurrence. Celle-ci caractérise comme une compétition entre des firmes dans un cadre régulé, celui du marché. La concurrence est vertueuse lorsqu'elle est combinée avec un mécanisme de coopération qui prévaut entre des États et des institutions publiques qui fixent les règles du jeu : des normes sanitaires, des droits de douane, des normes environnementales. On parle de guerre économique lorsque ce sont les États eux-mêmes qui entrent en confrontation directe, et qui, dans une logique mercantiliste, cherchent à affaiblir la puissance économique de leurs partenaires. L'histoire enseigne que ce type de stratégie engendre à long terme des effets récessifs mutuels. En économie, il est établi que la guerre économique est un jeu à somme négative.
Il est aujourd'hui admis que Trump promeut une doctrine fondée sur une défiance généralisée, un rapport de force systématique et un mépris de moins en moins dissimulé à l'égard des institutions démocratiques. Il remet en cause tous les engagements multilatéraux signés par les États-Unis de longue date (OMC, G20, OTAN ou encore l'accord de Paris sur le climat). S'agissant des relations économiques, sa politique repose sur un principe de prédation : imposer unilatéralement aux autres pays certaines conditions commerciales, créer des dépendances stratégiques notamment sur la question de l'énergie, et exiger en retour une docilité voire une soumission de la part de ses partenaires.
« L'accord commercial » du 27 juillet avec l'Union européenne : soumission sans contrepartie ?
L'accord signé à Washington le 27 juillet 2025 entre la Commission européenne et l'administration Trump est un cas d'école de cette logique de domination. Présenté comme un accord de principe, il s'apparente en réalité à une série de concessions unilatérales faites par l'Union européenne pour éviter l'escalade dans la guerre économique avec les États-Unis. Depuis sa parution, une partie conséquente de la presse européenne mais aussi aux États-Unis considère que l'Union européenne vient de connaître un revers historique qui s'apparente à une humiliation. Cet accord imposé par Donald Trump repose sur trois volets principaux :
- Les pays de l'Union européenne acceptent l'instauration d'un système de droits de douane moyen à hauteur de 15% sur de nombreux secteurs (produits pharmaceutiques, automobile, semi-conducteurs), avec un maintien de droits plus élevés comme sur la sidérurgie (50%) ou sur le secteur de l'électronique (jusqu'à 25%). Ce taux de 15 % est globalement unilatéral, ce qui signifie que les États-Unis imposent des droits élevés sur certains produits européens sans obligation de réciprocité tarifaire équivalente pour l'économie US. Même si certains secteurs restent encore à déterminer comme celui des vins et spiritueux, le caractère déséquilibré de l'accord est bien manifeste.
- Le deuxième volet de l'accord porte sur l'accès élargi des produits américains au marché européen, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'armement. Cela suppose donc que des droits de douane réciproques ne soient pas mis en place par l'Union européenne à l'égard des firmes américaines exportatrices.
- Enfin, le dernier volet porte sur l'engagement de l'Union européenne et de ces acteurs économiques à investir sur le sol américain. Sur une échéance de 3 ans l'accord prévoit jusqu'à 600 milliards d'euros d'investissements directs européens et surtout, des garanties concernant les importations de produits fossiles US pour un montant total de 750 milliards de dollars, soit 250 milliards par an.
Comment expliquer la signature de cet accord par la présidence de la Commission européenne ?
Même s'il est difficile avec peu de recul de tirer des conclusions définitives, plusieurs pistes émergent et mettent en évidence le fait que les marges de manœuvre de Ursula von Der Leyen sont à ce jour très faibles. Un des arguments avancés est celui de la volonté d'éviter une escalade tarifaire qui serait à moyen terme plus coûteuse à l'Union européenne. Donald Trump avait en effet menacé l'Union européenne de droits de douane allant de 30 à 50 % ce qui aurait pu causer des perturbations plus graves encore sur l'économie du vieux continent. Un autre argument est celui de la stabilité économique à moyen terme : l'objectif est de permettre aux firmes européennes de s'organiser pour rechercher d'autres marchés que celui des Etats-Unis dès lors que la guerre commerciale généralisée est évitée. Il existe par ailleurs des raisons qui concernent la gouvernance interne de l'UE : certains États membres à l'image de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Irlande ont revendiqué préférer un compromis imparfait plutôt qu'une absence d'accord et une montée en tension avec l'administration américaine. En bref : la présidente de la Commission européenne a signé cet accord afin d'éviter le pire sur le plan commercial. Enfin, il faut signaler le lien politique implicite qui existe entre cet accord et la pérennité de l'implication des États-Unis dans l'OTAN et par extension de sa participation au soutien à l'Ukraine. Là encore, la situation révèle la forte dépendance politique de l'Europe à l'égard des États-Unis et réduit donc la possibilité pour la Commission d'entrer dans une confrontation ouverte avec l'administration Trump.
Les ressorts de la souveraineté économique européenne : tout est à construire
Cet épisode du mois de juillet 2025 révèle en fin de compte la faible souveraineté de l'Union européenne. On dit d'une institution politique ou d'un Etat qu'il est souverain dès lors qu'il parvient à imposer ses choix grâce à un pouvoir de contrainte sans être, en retour, influencé par les choix d'institutions extérieures. Dans les sociétés fondées sur des systèmes démocratiques la souveraineté implique de parvenir à imposer le droit. Sur le plan économique, cette institution est souveraine si elle est en mesure, par ses choix, d'influencer l'ordre économique qu'il environne et qu'elle ne se trouve pas en situation de dépendance unilatérale pour la satisfaction des besoins de ses propres agents. Bien entendu, nul n'est jamais totalement souverain. Et l'expression de satisfaction des besoins est ambiguë. Elle pose la question des secteurs stratégiques par lesquels cette souveraineté peut s'exprimer (l'agriculture pour l'indépendance alimentaire, la technologie pour le secteur du numérique, la défense pour le maintien de la paix, la pharmacie pour les enjeux sanitaires, etc.). Cette souveraineté suppose également une capacité d'imposer ses choix contre ceux des autres régions du monde à l'image de la Chine ou… des États-Unis.
On pourrait considérer, à l'image de nombreuses prises de positions publiques depuis le 27 juillet, que la Commission européenne aurait dû refuser cet assujettissement à la politique agressive de Trump. Mais dans ce cas, il ne faut pas sous-estimer ce qu'aurait été le cout macroéconomique d'un tel choix, bien entendu en termes de droits de douane mais aussi à moyen terme s'agissant des parts de marchés des entreprises de l'union dans l'économie US. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'incertitude que le refus de cet accord aurait généré sur l'équilibre géopolitique de l'Europe qui est déjà très fragile. Mais d'un autre côté, Il est manifeste que la signature de cet accord ne renforce pas la souveraineté économique de l'Europe mais au contraire la réduit encore davantage. Même s'il s'agit de déclarations de principes sans obligation de résultat, les engagements économiques signés dans l'accord et repris très officiellement par Trump vont à l'encontre de la construction de cette souveraineté pour au moins trois raisons :
- Nous avons un besoin de réindustrialisation de notre système productif ce qui implique une mobilisation de l'épargne et des stratégies d'investissements internes au territoire européen. La promesse d'un investissement de firmes sur le territoire US apparait de ce point de vue totalement contreproductive et de surcroit hors des compétences de la Commission. La souveraineté implique aussi de tisser des relations commerciales stables entre firmes des différents territoires afin de pouvoir raccourcir les chaines de valeur au sein de l'espace européen tout en diversifiant les fournisseurs. Se lier les mains dans un engagement industriel hasardeux avec les US, c'est prendre le chemin inverse ;
- La deuxième raison concerne le volet de rachat de produits fossiles US. Outre le montant qui excède largement les importations fossiles européennes actuelles, cette « clause » entre en contradiction totale avec la politique climatique de décarbonation de l'économie de l'UE. Or, l'objectif de zéro émission nette a aussi une composante stratégique et participe de la souveraineté économique de l'Europe. On ne voit pas bien à ce titre en quoi la signature de cet accord est un optimum de second rang.
- Enfin, la dernière raison porte sur la question de l'incertitude économique. Il est acquis aujourd'hui que la présidence Trump accroit de façon considérable cette incertitude dans les relations internationales. Elle dégrade la confiance dans les institutions et dans les relations interétatiques comme aucune autre administration depuis de nombreuses décennies. Or, dans le « pari » de la Commission, il y a cette idée première que signer un « mauvais » accord vaut mieux que pas d'accord du tout. A ce jour, aucun argument fondé en raison ne permet de dire que cette stratégie est vouée à l'échec mais on peut la considérer hasardeuse. Jusqu'à présent, Donald Trump n'a fonctionné que sur le principe du rapport de force brut et il n'a jamais respecté ses engagements. Rien ne permet donc de dire qu'une posture ferme de l'UE refusant un tel « accord » qui aurait certes conduit à des droits de douane de 30 % ou plus comme cela se produit pour le Canada aurait généré plus d'incertitude ou aurait conduit à une situation pire pour les intérêts de l'Europe y compris s'agissant de la guerre en Ukraine. En outre, la construction de la souveraineté européenne ainsi que l'atteinte de nos objectifs essentiels que sont la réindustrialisation et la décarbonation impliquent des coûts collectifs qu'il faudra de toutes façons supporter. Le sentiment qui domine aujourd'hui est que la Commission a simplement cherché à gagner du temps sans qu'une stratégie politique claire de l'UE soit par ailleurs engagée.
En fin de compte, il est manifeste que les tensions politiques comme économiques entre les deux côtés de l'Atlantique atteignent aujourd'hui des seuils inégalés depuis de longues décennies. L'Union européenne est incontestablement à l'épreuve de la politique prédatrice de Trump. Nous devons continuer de composer avec notre mode de gouvernance : démocratique certes mais peu fédéral de sorte qu'il est plus difficile pour les institutions européennes de tenir les rapports de force sur le front politique international. Pour autant, les structures productives de l'Europe sont solides et nous représentons un marché de près de 500 millions de consommateurs. Nous avons donc des arguments à faire valoir pour imposer nos vues. La souveraineté est un défi : relevons-le !
